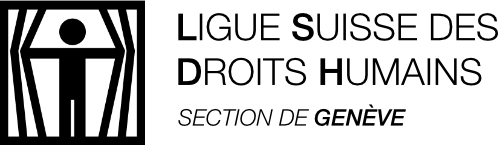Après la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en 2021[1], c’est aujourd’hui le Tribunal fédéral qui rappelle au canton de Genève ses obligations découlant de l’application du principe de proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH, art. 36 al. 3 Cst.), en matière de respect des droits fondamentaux des personnes mendiantes.
Le point sur un long combat mené par l’avocate Dina Bazarbachi pour le respect des droits fondamentaux des personnes roms en Suisse.
[1] Arrêt de la CourEDH, Lacatus c. Suisse, du 19 janvier 2021, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-207377%22]}
En 2021, la Suisse a été condamnée pour avoir sanctionné une personne mendiante – une femme rom qui se trouve dans une précarité extrême – d’une sanction particulièrement grave et disproportionnée. La CourEDH a jugé que l’interdiction générale de la mendicité alors en vigueur à Genève, combinée à la conversion automatique des amendes impayées en peine de prison, constituait une violation de ses droits fondamentaux (notamment art. 8 CEDH). Elle a également relevé l’absence de motifs justificatifs sérieux d’intérêt public, comme la protection des passants, des résidents ou des commerçants, et souligné la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives.
À la suite de cet arrêt, plusieurs cantons, dont Genève, ont été contraints de modifier leurs législations. En lieu et place des interdictions générales de mendicité désormais jugées illicites, ces cantons ont adopté des interdictions « localisées », fondées sur une liste étendue de lieux dans et « aux abords » desquels la mendicité est prohibée.
À Genève, l’article 11A al. 1 let. d de la Loi pénale genevoise (LPG), dans sa teneur de 2021, prévoit une amende pour quiconque mendie dans ou « aux abords » de zones commerciales ou touristiques prioritaires, de bâtiments administratifs, d’arrêts de transports publics (y compris des gares), etc. Les législations de Bâle et Vaud contiennent des restrictions similaires. Le canton de Vaud, en particulier, est allé plus loin en incluant notamment les files d’attente devant les établissements de vente à l’emporter, les entrées d’immeubles résidentiels et de bureaux, ainsi que tous les bâtiments et installations publics.
Dans les faits, ces nouvelles lois constituent donc un retour masqué de l’interdiction générale de la mendicité, frappant de manière injuste et disproportionnée des personnes qui ne font que tendre la main pour survivre.
Face à cette réalité, le Tribunal fédéral (TF) a été saisi de plusieurs recours liés à des situations concrètes de personnes sanctionnées en application de l’art. 11A LPG. Ainsi, dans plusieurs arrêts essentiels et justifiés rendus le 19 mars 2025[1], le TF a jugé que ces sanctions demeuraient contraires aux droits fondamentaux, en particulier du principe de proportionnalité garanti par la Constitution.
Le Tribunal a d’abord relevé que la notion « d’abords », utilisée dans la législation genevoise, est juridiquement floue et indéterminée. Une telle imprécision rend la norme difficilement compréhensible, notamment pour des personnes peu scolarisées ou allophones, et ne permet pas de savoir clairement où la mendicité est autorisée ou interdite. Par ailleurs, le TF critique le caractère systématiquement pénal de la répression. Il estime qu’un simple avertissement ou une mesure administrative aurait été suffisant et moins incisif. En outre, les décisions rendues après interpellation ne sont pas rédigées de manière suffisamment claire, notamment en ce qui concerne les sanctions encourues.
Le Tribunal relève également que, dans l’immense majorité des cas, les personnes mendiantes n’ont, par définition, pas les moyens de payer les amendes infligées, ce qui conduit à leur conversion automatique en peine privative de liberté. Cette pratique, profondément choquante et inacceptable, conduit à l’emprisonnement de personnes uniquement en raison de leur précarité, revenant ainsi à criminaliser la misère elle-même. Pourtant, l’art. 106 al. 2 du Code pénal prévoit qu’une telle conversion ne peut avoir lieu qu’après un examen de la proportionnalité et une analyse de la « faute ». Le Tribunal fédéral constate que cette exigence reste purement théorique et qu’elle n’est pas appliquée en pratique, ce qui constitue une nouvelle violation des droits fondamentaux.
Enfin, le Tribunal n’a pas examiné un vice de procédure pourtant manifeste dans les ordonnances pénales émises en la matière par le Service des contraventions, au motif que ce grief a été soulevé trop tard. Il n’en demeure pas moins que ces ordonnances ne sont pas signées par une autorité compétente au sens de la loi : elles ne comportent qu’une signature préimprimée et non une signature manuscrite, en violation de l’article 80 al. 2 du Code de Procédure pénale. Il est ainsi impossible de vérifier si la personne à l’origine de ces décisions disposait réellement de la compétence requise, ce qui entache gravement la validité juridique de ces actes.
Aujourd’hui, le canton de Genève, et plus largement les autres cantons suisses concernés, se voient donc à nouveau contraints de revoir leur législation en matière de mendicité. Il est grand temps que les cantons renoncent définitivement à pénaliser une pratique qui n’est rien d’autre qu’un appel à la solidarité, en abrogeant purement et simplement les dispositions répressives en vigueur. Maintenir une telle répression expose non seulement la Suisse à de nouvelles condamnations par les juridictions nationales ou européennes, mais constitue surtout une atteinte grave aux droits fondamentaux.
Parallèlement, une décision politique s’impose quant au sort des personnes actuellement incarcérées pour avoir mendié – ou pour n’avoir pas eu les moyens de s’acquitter d’une amende – et qui, faute de ressources, n’ont jamais pu faire valoir leurs droits devant le Tribunal fédéral. Il est inacceptable que, dans un État de droit, la pauvreté reste un motif d’enfermement.
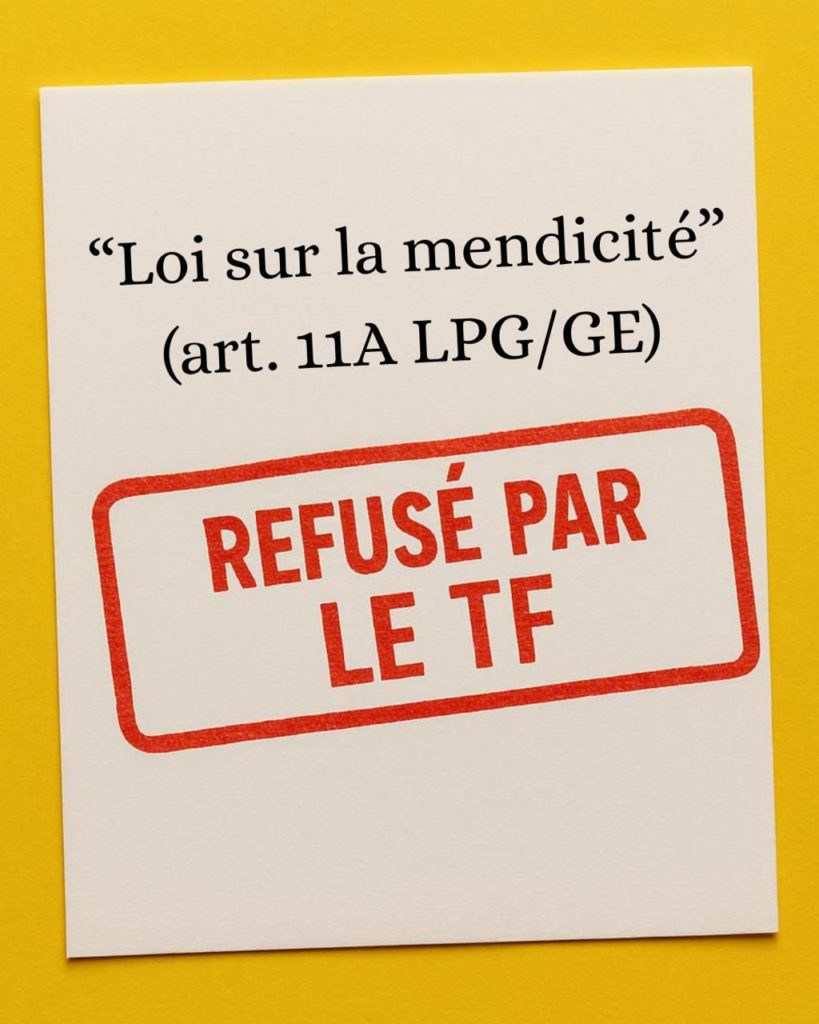
[1] Voir les arrêts du Tribunal fédéral 6B_216/2024, 6B_462/2024, 6B_714/2024, 6B_715/2024, 6B_923/2024, 6B_923/2024, 6B_933/2024 du 19 mars 2025, publiés sur le site du Tribunal fédéral le 4 juin 2025.